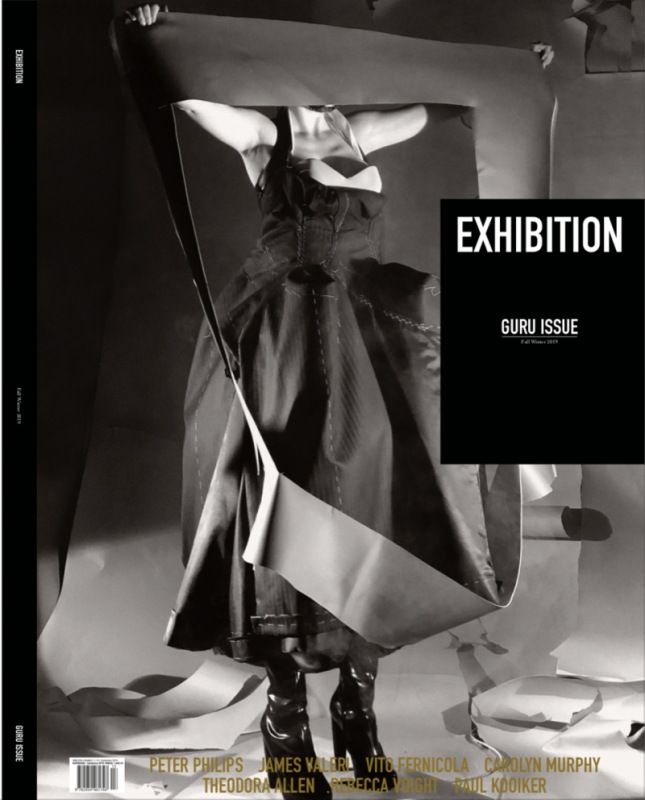
La
magie de la mode. Logique
de mode et pensée magique
Ce
que l'on appelle la « magie » de certaines formes de
divertissement spectaculaire, que ce soit des parcs d'attraction, des
feux d'artifice ou du cinéma hollywoodien, se retrouve également
dans les représentations de mode. Les défilés, notamment, se
présentent comme des images d'un autre monde, éblouissants à-côtés
du réel, lieux
d'illusionnisme et d'émerveillement renouvelé. Ici, le fantasme
s'incarne et les rêves prennent corps : on voit défiler chez
Gucci des femmes aux oreilles d'or et aux larmes devenues bijoux,
chez Charles Jeffrey, on retrouve des atmosphères de grand bal
queer, en forme d'ode à l'extravagance, tandis que défilent
chez Comme des Garçons des silhouettes tout droit sorties d'un rêve
gothique, précieux et futuriste. Mais s'il y a une « magie de
la mode », ce n'est pas seulement parce qu'elle échappe, par
ses fastes ou par sa théâtralité, au domaine de l'existence
quotidienne. Elle est aussi une magie au sens strict, inhérente
au monde et à son expérience quotidienne, c'est-à-dire un moyen de
produire du sens, d'appréhender le réel et de s'y frayer des voies,
mais encore un mode d'action, un pouvoir, une force exercée sur les
choses et les
hommes. Elle est la
magie pratique et concrète dont Marcel Mauss a pensé un modèle
universel, celle à qui Lévi-Strauss rend toute sa dignité
intellectuelle dans La
pensée sauvage, système
cohérent de pensée
et d'action, bien moins chaotique qu'on ne veut le croire. Pour
comprendre cela, il ne faut peut-être plus tant regarder vers les
podiums eux-mêmes, que vers leurs effets, leur influence, en somme
vers les formes de pouvoir qu'ils exercent.
Le
« mana » de la mode
Dans
l'Esquisse d'une théorie
générale de la magie,
Marcel Mauss décrit toute magie comme force de résolution d'un
problème concret dont se préoccupe l'ensemble d'une société –
et dans problème concret on peut autant entendre blocage technique
qu'angoisse, incertitude collective. La mode tâche, dans cette
perspective, de répondre à la question de l'apparence légitime de
l'homme, question du « comment apparaître ? ». Elle
vient s'offrir en réponse au désir d'apparaître encore,
d'apparaître mieux, d'augmenter et de renouveler sans cesse les
charmes du corps. Réponse concrète à l'inquiétude de l'image de
soi, elle se constitue en action salvatrice, selon une temporalité
rituelle du recommencement, investissant toujours de nouveaux objets
de sa puissance. Elle est en cela une incarnation de ce que Mauss
appelle le « mana », ou puissance magique, puissance
de conviction et de résolution, « impersonnelle » dans
sa pérennité et son autorité (depuis des siècles c'est la
mode
qui remodèle périodiquement l'image du corps) mais « revêtant
des formes personnelles » (toutes les
modes
qui vivent un temps), existant dans le monde matériel par
l'entremise d'êtres ou de formes individués. Ce pouvoir protéiforme
de la
mode, transcende tous les lieux dans lesquels il se manifeste
ponctuellement : il n'appartient jamais à une forme, jean
moulant ou pantalon large, minijupe ou robe longue, etc., mais en
fait seulement le véhicule temporaire de sa puissance. Il faut ici
remarquer que comme toute magie, la mode institue son
propre champ de force et donc de légitimité, elle pose les
conditions de possibilité de sa propre efficacité : elle
répond à des questions dont elle détermine elle-même la
formulation.
La
couture comme art divinatoire
Mais
pour que des objets soient investis de ce pouvoir de mode et soient
capables de répondre à la question du « comment apparaître »,
il faut des médiateurs, des intercesseurs, des personnes capables de
les produire, ou au moins de les désigner comme tels. Il faut un
magicien, pour transformer une forme vestimentaire quelconque en
icône de mode : il faut Jacquemus, pour faire de la blouse de
grand-mère à pois un objet de rêve, il faut Maria Grazia Chiuri
pour déclencher une passion mondiale du béret en cuir. Et de fait,
celui ou celle
qui confie la responsabilité de ses apparences aux visions d'un
designer, lui fait confiance comme au détenteur d'une puissance
esthétique mystérieuse et incontestée, qui serait aussi une force
de compréhension du présent. C'est d'ailleurs un lieu commun de la
théorie de la mode que de dire que les couturiers sont « en
avance sur leur temps », et qu'ils voient plus loin que tous
leurs contemporains. Les
corps soumis à la mode se comprennent dès lors comme en position
d'attente, attente d'une révélation du futur, passant par le médium
qu'est le couturier, et qui ne pourrait advenir sans lui : :
Alessandro Michele n'est peut-être pas si loin du métier de son
père, qui était chaman.
À la confluence d'un monde commun
et d'un monde seulement pressenti ou rêvé, au croisement du
matériel et de l'invisible, du présent et du futur, le
designer amène ainsi à la vie des
formes latentes, venant frapper par l'intermédiaire de son esprit à
la porte de leur réalisation.
La
puissance charismatique du couturier
Mais
si les représentations de mode, et surtout les propositions des
couturiers, sont élevées au rang de paroles sacrées et semblent
pouvoir être qualifiées de visionnaires, c'est aussi en raison de
la confiance qui leur est faite par leurs fidèles. La foi en une
parole de mode amène à sa réalisation dans le monde : c'est
son public, ses adeptes, qui font du couturier un magicien, et qui
rendent réels ses oracles. C'est dans cette perspective que Pierre
Bourdieu et Yvette Delsault, dans un article de 1975 intitulé « Le
couturier et sa griffe : contribution à une théorie générale
de la magie » font du couturier l'opérateur d'une « alchimie
sociale ». Une fois sa légitimité reconnue par tous, il
transforme, par l'intermédiaire de sa griffe, le vêtement en objet
sacré, opérant ainsi, au moyen de son « pouvoir
charismatique », une véritable transsubstantiation de toutes
ses créations, dès lors investies d'une valeur transcendante. Le
phénomène récent de capitalisation du nom des influenceuses et
notamment des reines d'Instagram lançant des marques de mode offre
un exemple frappant de cette transformation du produit par la
puissance charismatique de l'individu. Car ce ne sont pas même en
tant que produits du travail d'un designer expert que leurs créations
sont achetées, mais seulement en tant qu'elles s'inscrivent sous
l'autorité symbolique d'une jeune femme, belle et admirable, et
donc, qu'elles renvoient, par suggestion, à un monde esthétique, à
un paysage imaginaire, à un récit existentiel dont la consommatrice
rêve d'être aussi l'actrice. À l'influenceuse, on fait donc
confiance comme à une source surnaturelle de prestige et de beauté :
l'on revêt, en s'enveloppant de son nom, l'ombre de ses qualités.
Affabulations
concrètes
Cette
participation à un monde imaginaire, que celui-ci soit créé
par Grace Wales Bonner, ou incarné
par Jeanne Damas, constitue une des dimensions fondamentales de la
mode. Dans le rayonnement imaginaire d'une pièce, dans tous
l'univers que l'on projette sur elle, mais aussi dans la capacité
qu'elle a à suggérer, à faire pressentir des aperçus de ce monde
à ceux que l'on croisera en la portant, bref, dans ce lien entre le
textile et le fantasme, s'identifie un des ressorts fondamentaux de
sa puissance, qui est avant tout une puissance suggestive. Un
vêtement « fait » ceci ou cela : dans une telle
tenue, on fait bibliothécaire,
dans telle autre on fait princesse r'n'b, on fera un jour grande
dame, un autre garçon manqué, etc. Et c'est précisément la
fabrique de
ce personnage temporaire qui apaise l'esprit, et qui fonde la vertu
curatrice de la mode. Car en lui on se connaît momentanément une
forme, une direction, presque un destin.
La force de la mode est de savoir ravir le corps et le faire vivre,
par le biais de l'image, autre part, de la vie d'une belle histoire
qui, si elle est comme une éthique rêvée, achevée, ne profite que
d'une expression brève et fragile.
Dans ce récit visuel de soi, réécrit par dessus celui de
l'histoire biographique, de l'intériorité ou des actes, advient un
ordre nouveau, une autre dimension de la personne, ordre
d'affabulation concrète et de fantasme réalisé. S'y combinent
en une même silhouette, des
lambeaux de narrations diverses, qui se nuancent, se confirment ou
s'infirment dans leurs lectures possibles – le décolleté profond
nuance l'oversize,
les sneakers
nuancent le costume trois-pièces, etc. La composition d'une tenue
est alors comme la possibilité retrouvée – pour quelques heures –
d'une existence, ou mieux, de plusieurs existences que l'on aurait pu
vivre, elle aménage des combinaisons impossibles, des rêves de
puzzles existentiels, obéissant autant à des lois formelles qu'à
des croisements éthiques complexes, où chaque genre, chaque
narration implicite doit s'équilibrer avec telle autre.
Poussant
nos qualités d'identification et d'imagination sur le chemin d'un
irrésistible vagabondage, elle se constitue en pratique active de
recréation du réel, où les objets comme l'être se révèlent
volatils et poreux les uns aux autres, où les images vivent autant
par le biais des corps, que d'une intense existence fantasmatique.
Son pouvoir est celui d'une réforme magique de soi par l'image, de
la réalisation concrète d'un imaginaire existentiel : on peut
dire de la mode qu'elle nous donne à sentir, vivre et penser la
possibilité d'une vie autre, démultipliée, mettant au jour par sa
révolution permanente des mondes impossibles qu'elle donne à
sentir, à percevoir, par la seule force de sa suggestion.